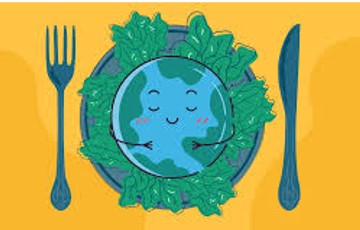
Retrouvez régulièrement une question/réponse autour de l’alimentation durable.
Question 1/10 : Comment adapter sa consommation de viande aux enjeux environnementaux ?
L’élevage a une empreinte environnementale forte qui se décline sur plusieurs plans [1, 2] :
- Les émissions de gaz à effet de serre, avec 14,5% des émissions mondiales issues de l’élevage dont 9,3% pour les bovins
- La consommation des ressources en eau
- L’utilisation des terres pour l’alimentation animale avec des problématiques de déforestation, émissions de polluants dans l’air, pollution des sols, de l’eau (rejets de nitrates) …
En pratique, il existe trois leviers principaux pour adapter sa consommation de viande aux enjeux environnementaux.
1. Réduire sa consommation
Face à l’ensemble des problématiques environnementales mais aussi pour des raisons de santé, la communauté scientifique s’accorde aujourd’hui sur la nécessité de réduire la consommation de viande pour aller vers un rééquilibrage entre la consommation d’aliments d’origine végétale et de produits d’origine animale.
Sans nécessairement exclure les produits animaux qui sont sources de nutriments indispensables à l’équilibre nutritionnel – protéines de bonne qualité (au profil en acides aminés optimal), ainsi que des vitamines et minéraux tels que le fer héminique (viande), le calcium (produits laitiers) ou la vitamine B12 – il est recommandé aux adultes de limiter leur consommation à moins de 500 g/semaine pour la viande hors volaille, à 2 portions/jour pour les produits laitiers et à moins de 150g /semaine pour la charcuterie, selon les recommandations du PNNS 2019-2023. [1, 3, 4]
Cependant, plusieurs modélisations du régime alimentaire durable recommandent une consommation de viande inférieure à la limite établie par le PNNS. C’est le cas du scénario mondial Eat-Lancet qui recommande une consommation d’environ 100g par semaine de viande hors-volaille (boeuf, porc, agneau…) et 200g par semaine de poulet ou autre volaille. [5]
Notons cependant qu’il est nécessaire de prendre en compte que certaines catégories de population ont des besoins protéiques plus élevés (personnes âgées, femmes enceintes, …). [2]Par ailleurs, il est aussi important de prendre en compte la notion de culture et d’acceptabilité des populations pour émettre des recommandations applicables.
2. Privilégier les produits carnés avec une plus faible empreinte
D’après la FAO, la viande bovine émet 295 kgCO2eq par kg de protéines, soit presque 10 fois plus que du poulet ou des oeufs (35 et 31 kgCO2eq par kg de protéines respectivement), et presque 5 fois et demie plus que du porc (55 kgCO2eq par kg de protéines). [6] C’est pourquoi toutes les sources de protéines animales ne se valent pas en termes d’impacts : il vaut mieux privilégier le poisson, les oeufs, la volaille, ou le porc par rapport à une viande de boeuf.
3. Favoriser les produits issus de pratiques durables
Il existe des pratiques d’élevage plus vertueuses qui limitent leur impact environnemental et apportent des services écosystémiques.
On peut noter par exemple que le Label Rouge pour les bovins impose un minimum de 5 mois de pâture. [7] Or le pâturage permet un maintien des prairies qui rendent des services écosystémiques et sont favorables à la biodiversité, au stockage de carbone et à la filtration de l’eau. [2]
Les labels Agriculture Biologique, Bio Cohérence, Nature & Progrès et Demeter limitent les traitements antibiotiques, posent des contraintes sur l’alimentation des bovins (interdiction des OGMs comme le soja d’Amérique du Sud, interdiction d’utilisation de produits de synthèse pour produire les aliments destinés aux animaux, favorisation des fourrages locaux…), limitent le transport du bétail et imposent un accès en extérieur. [8]
Le label Haute Valeur Environnementale quant à lui a vocation à préserver la biodiversité (insectes, arbres, haies, variétés végétales et animales diversifiées et préservation des races menacées…), limite l’utilisation de produits de synthèse pour la production des aliments destinés aux bovins et requiert une optimisation de la quantité d’eau consommée par la ferme d’élevage. [8]

[1] notre-environnement.gouv.fr https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/alimentation-et-environnement-les-enjeux-de-la-consommation-de-viande-en-france?type-ressource=indispensable&lien-ressource=5203&theme-ressource=439&type-liaison=indispensable&ancreretour=ressources
[2] INRAE, les enjeux de la consommation de viande
https://www.inrae.infrawan.fr/actualites/quels-sont-benefices-limites-dune-diminution-consommation-viande
[3] PNNS 2019-2023 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
[4] ANSES https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-actualise-les-rep%C3%A8res-de-consommations-alimentaires-pour-la-population-fran%C3%A7aise
[5] Eat Lancet, rapport 2019 https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_French.pdf
[6] FAO : https://www.fao.org/gleam/results/fr/
[7] Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), Les signes de qualité et d’origine, le label rouge, https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Guides-pratiques/Conditions-de-production-communes-en-label-rouge
[8] ADEME, les labels environnementaux (viande de boeuf),
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux#labelsrow-3
[Rédigé par Nestlé Nutripro]
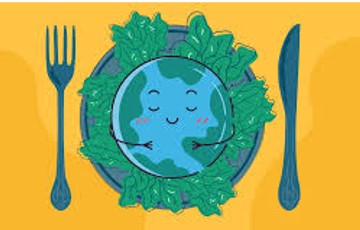
Retrouvez régulièrement une question/réponse autour de l’alimentation durable.
Question 1/10 : Comment adapter sa consommation de viande aux enjeux environnementaux ?
L’élevage a une empreinte environnementale forte qui se décline sur plusieurs plans [1, 2] :
- Les émissions de gaz à effet de serre, avec 14,5% des émissions mondiales issues de l’élevage dont 9,3% pour les bovins
- La consommation des ressources en eau
- L’utilisation des terres pour l’alimentation animale avec des problématiques de déforestation, émissions de polluants dans l’air, pollution des sols, de l’eau (rejets de nitrates) …
En pratique, il existe trois leviers principaux pour adapter sa consommation de viande aux enjeux environnementaux.
1. Réduire sa consommation
Face à l’ensemble des problématiques environnementales mais aussi pour des raisons de santé, la communauté scientifique s’accorde aujourd’hui sur la nécessité de réduire la consommation de viande pour aller vers un rééquilibrage entre la consommation d’aliments d’origine végétale et de produits d’origine animale.
Sans nécessairement exclure les produits animaux qui sont sources de nutriments indispensables à l’équilibre nutritionnel – protéines de bonne qualité (au profil en acides aminés optimal), ainsi que des vitamines et minéraux tels que le fer héminique (viande), le calcium (produits laitiers) ou la vitamine B12 – il est recommandé aux adultes de limiter leur consommation à moins de 500 g/semaine pour la viande hors volaille, à 2 portions/jour pour les produits laitiers et à moins de 150g /semaine pour la charcuterie, selon les recommandations du PNNS 2019-2023. [1, 3, 4]
Cependant, plusieurs modélisations du régime alimentaire durable recommandent une consommation de viande inférieure à la limite établie par le PNNS. C’est le cas du scénario mondial Eat-Lancet qui recommande une consommation d’environ 100g par semaine de viande hors-volaille (boeuf, porc, agneau…) et 200g par semaine de poulet ou autre volaille. [5]
Notons cependant qu’il est nécessaire de prendre en compte que certaines catégories de population ont des besoins protéiques plus élevés (personnes âgées, femmes enceintes, …). [2]Par ailleurs, il est aussi important de prendre en compte la notion de culture et d’acceptabilité des populations pour émettre des recommandations applicables.
2. Privilégier les produits carnés avec une plus faible empreinte
D’après la FAO, la viande bovine émet 295 kgCO2eq par kg de protéines, soit presque 10 fois plus que du poulet ou des oeufs (35 et 31 kgCO2eq par kg de protéines respectivement), et presque 5 fois et demie plus que du porc (55 kgCO2eq par kg de protéines). [6] C’est pourquoi toutes les sources de protéines animales ne se valent pas en termes d’impacts : il vaut mieux privilégier le poisson, les oeufs, la volaille, ou le porc par rapport à une viande de boeuf.
3. Favoriser les produits issus de pratiques durables
Il existe des pratiques d’élevage plus vertueuses qui limitent leur impact environnemental et apportent des services écosystémiques.
On peut noter par exemple que le Label Rouge pour les bovins impose un minimum de 5 mois de pâture. [7] Or le pâturage permet un maintien des prairies qui rendent des services écosystémiques et sont favorables à la biodiversité, au stockage de carbone et à la filtration de l’eau. [2]
Les labels Agriculture Biologique, Bio Cohérence, Nature & Progrès et Demeter limitent les traitements antibiotiques, posent des contraintes sur l’alimentation des bovins (interdiction des OGMs comme le soja d’Amérique du Sud, interdiction d’utilisation de produits de synthèse pour produire les aliments destinés aux animaux, favorisation des fourrages locaux…), limitent le transport du bétail et imposent un accès en extérieur. [8]
Le label Haute Valeur Environnementale quant à lui a vocation à préserver la biodiversité (insectes, arbres, haies, variétés végétales et animales diversifiées et préservation des races menacées…), limite l’utilisation de produits de synthèse pour la production des aliments destinés aux bovins et requiert une optimisation de la quantité d’eau consommée par la ferme d’élevage. [8]

[1] notre-environnement.gouv.fr https://www.notre-environnement.gouv.fr/actualites/breves/article/alimentation-et-environnement-les-enjeux-de-la-consommation-de-viande-en-france?type-ressource=indispensable&lien-ressource=5203&theme-ressource=439&type-liaison=indispensable&ancreretour=ressources
[2] INRAE, les enjeux de la consommation de viande
https://www.inrae.infrawan.fr/actualites/quels-sont-benefices-limites-dune-diminution-consommation-viande
[3] PNNS 2019-2023 https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/pnns4_2019-2023.pdf
[4] ANSES https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-actualise-les-rep%C3%A8res-de-consommations-alimentaires-pour-la-population-fran%C3%A7aise
[5] Eat Lancet, rapport 2019 https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_French.pdf
[6] FAO : https://www.fao.org/gleam/results/fr/
[7] Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), Les signes de qualité et d’origine, le label rouge, https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-comment-faire/Guides-pratiques/Conditions-de-production-communes-en-label-rouge
[8] ADEME, les labels environnementaux (viande de boeuf),
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux#labelsrow-3
[Rédigé par Nestlé Nutripro]



